| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |
| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |
|
Moi, laminaire…
Cadastre Suivi de Moi, laminaire..., Aimé Césaire • Éditeur Points, Paris • ISBN 2-02-086388-X • 2006 • 6 €. |
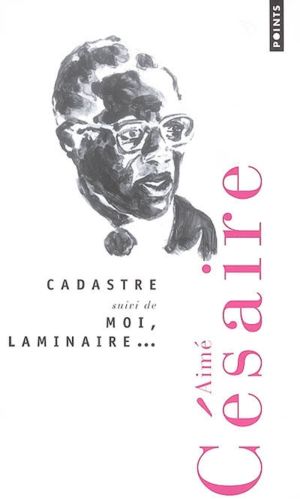 |
Je remercie Christian Lapoussinière de m’avoir convié à ce colloque-anniversaire organisé à l’occasion des 90 ans d’Aimé Césaire. L’homme, le poète qui a été –et qui demeure pour moi – la porte d’entrée somptueuse par laquelle la lumière de la conscience d’être se trouva à la fois révélée, manifestée et magnifiée. Comme tant d’autres, je me suis jamais remis de cet embrasement poétique et politique même si je suis enclin aujourd’hui à juger et à jauger la notion de «négritude» avec les apports nouveaux des sciences humaines.
Je voudrais, avant d’aborder mon sujet, vous inviter à partager avec moi le postulat suivant:
Un grand poète est plus grand que tous les mouvements littéraires, y compris celui qu’il a lui-même fondé et dont il se réclame. En ce sens Victor Hugo dépasse le romantisme, André Breton transcende le surréalisme et Aimé Césaire excède la négritude. Vouloir lire Aimé Césaire exclusivement comme poète de la négritude c’est, à mon humble avis, mettre en cage une œuvre dont le principe même est celui des libertés éruptives, du marronnage créateur, de la subversion insolente, orgueilleuse et rédemptrice.
Ceci étant admis, qu’il me soit permis de poursuivre, à haute voix, une méditation commencée en 1982, l’année de la parution de Moi, laminaire…
À l’époque, j’avais parcouru un versant de ce «moi». Celui de la mangrove dont les connotations laissaient croire en un quelconque enlisement désenchanté dans la matière visqueuse et flétrie d’un temps délité.
Aujourd’hui, je voudrais vous inviter à découvrir l’autre face de ce «moi»: celle que projette l’image du feu en ses multiples et rusées variations.
Car, à bien regarder, en dépit d’une lassitude plus feinte que réelle - posture quasi romantique et presque tragique d’un Orphée qui revisite le cheminement de sa quête - ce qui se joue et s’énonce dans ce recueil c’est l’attente d’un sursaut toujours espéré et d’une explosion en surtension dans les images les plus fortes et les plus récurrentes.
En ouverture, le poète se définit comme un «tourbillon de feu» «ayant craché volcan (ses) entrailles d’eau vive». Autrement dit comme un mouvement circulaire, une énergie purificatrice, une projection hors de soi du plus intime, du plus profond et du plus vrai. Cependant, ce «tourbillon de feu», par une sorte de contamination induite par l’écriture, se transforme en élément liquide à mi-chemin entre le geyser et la tornade «ayant craché volcan mes entrailles d’eau vive». Tous les éléments sont ici convoqués (la terre, l’eau, le feu, l’air), dans ce que j’appellerai un précipité bachelardien, pour installer le lecteur au cœur vivant de la création figurée d’un monde. D’où le statut ambigu des matériaux qui «s’empruntent» l’un à l’autre leurs forces dans un jeu d’interactivité biologique. Mouvement séquencé où s’oppose le passé actif (ayant craché) à un présent résiduel (je reste). Le volcan, comme vidé en vain de ses «entrailles» est rendu pourtant à l’essentiel: la parole poétique symbolisée par les «pains de mots» et les «minerais secrets». En écho de ces possessifs, nous entendons le fameux «ce qui est à moi» du Cahier d’un retour au pays natal avec néanmoins un décentrement d’importance.
Dans le Cahier, il s’agissait d’inventorier un trésor à la fois géographique et historique pour mieux le restituer en legs majeur de la conscience souffrante. Ici, l’appropriation est sans détour et souveraine parce que nous sommes dans le registre personnel et fusionnel de la matière même de la création littéraire. C’est le «vates» qui livre (en se délivrant) la recette de son alchimie. Aux termes d’une ascèse, d’une parturition, la poche des eaux rompues, le placenta expulsé, demeure le «minerai» toujours en réserve pour une parole salutaire et le «pain des mots» aux vertus nourricières et bibliques.
Cela vient comme un aveu, une confidence entre la série anaphorique des «j’habite» dont le rythme se trouve brisé, suspendu, par la trouée apparemment impudique d’un rapport de soi à soi.
Par ailleurs, ce «tourbillon de feu» renvoie dans l’inconscient antillais à un être fabuleux appartenant au champ tératologique du conte et des mythes: le soucougnan. Etre qui se défait de sa peau, la nuit venue, pour se métamorphoser en une boule de lumière. Il erre alors à la recherche de ses proies et il doit, au lever du jour, ré-habiter son corps d’humain. Cette assertion n’est pas aussi risquée qu’elle le paraît puisque nous retrouvons métaphoriquement «et que ventouse le soleil» qui nous ramène au thème du vampire et à celui du sang des ventouses dites «coupées» dans les pratiques populaires d’antan.
Le poète-soucougnan réintègre sa peau, son lieu (j’habite) et son temps après s’être dénudé, écorché, dispersé. Ce n’est donc plus à un retour au pays natal que nous sommes confrontés mais bel et bien à un retour dans l’en-soi du moi poétique.
Ce volcan omniprésent se décline selon de multiples variations sémiologiques qui font de lui un acteur majeur de la scène (imaginaire ?) où se joue le drame assumé de l’accouchement retardé d’un monde autre.
C’est le volcan des «annonciades».
«que toute la cérémonie enfin a été ponctué par le tir
solennel des volcans installant de plein droit des lacs
dans leur cratère
poussants mon fol élan
feuillants ma juste demeure»
De quelle cérémonie est-il question ici?
De celle d’un combat, mystique et hugolien, que gagne la lumière sur l’ombre.
De celle d’une énergie positive reliant le «soleil» à la «collerette des salamandres»; c’est à dire le haut et le bas, le cosmique et l’animal, le tout au singulier, le tout au tout.
De celle d’un véritable big-bang par lequel le monde endormi ou en panne se remet en marche, se régénère en réinventant «de plein droit» un ordre du désordre que contemple la «mémoire irréductible» du poète. Cette mémoire, souvent citée, est enceinte de la blessure originelle et ontologique (ce qu’en d’autres termes Aimé Césaire appelle «l’antique déchirure») mais aussi de l’impérieuse nécessité de forger les armes d’un nouveau salut.
Là encore, Aimé Césaire revient sur le métier du démiurge. Il reçoit (seul?) la bonne nouvelle. Il déchiffre les signes lumineux. Il est le destinataire de la parole («elles me disent»). Il recueille la parole non humaine d’un Dieu caché (aucune instance d’énonciation ne nous indique l’auteur de la bonne nouvelle!) et la fait circuler à travers le poème avec l’enthousiasme d’un croyant. Un acte de foi est ainsi posé là devant nous à la manière d’une révélation mystique.
Remarquons cette technique, bien césairienne, du rétrécissement du champ pour communiquer la relation du tout au tout. Il y a le plan large où nous voyons «la cohue d’astres jaunes et rouges». Il y a le travelling qui traverse le corps du poème. Il y a enfin le gros plan sur «une goutte de sang» dont l’ascension stabilisée «au faîte du monde» culmine en fascination d’une «mémoire irréductible». Est-ce là une réminiscence du «soleil cou coupé»? Est-ce le sang du rachat christique? Est-ce «l’étincelle du feu sacré du monde»? Beaucoup d’hypothèses sont permises. Elles ramènent inévitablement au triangle césairien: sang/soleil/mémoire.
Il n’en reste pas moins vrai que nous sommes les spectateurs d’une irradiation, d’une propagation, d’une circulation vibratoire. L’univers dissocié au début se réconcilie avec lui-même, se sature de vitalité, à la manière d’une genèse d’autant plus «miraculeuse» qu’elle n’a pas d’ordonnateur apparent. Seule la revitalisation est ici consignée dans ses manifestations les plus extraordinaires.
Cette scène sera redoublée dans le poème dédié à Léon Gontran Damas:
«et puis ces détonations de bambous annonçant sans
répit
une nouvelle dont on ne saisit rien sur le coup
sinon le coup au cœur que je ne connais que trop»
Par la magie d’une transmutation dont le poète est l’alchimiste, le son se convertit en visions («je vois») car, comme toujours, l’enjeu c’est la lumière éclairante, dévoilante, révélante par où surgit la mémoire du «feu sombre».
Dans les deux cas, une investiture quasiment royale, solennelle, enjambe la mort (d’un pays/d’un frère) afin de lutter contre l’invasion de l’opacité en utilisant les ressources de «tout le soleil emmagasiné à l’envers du désastre».
Revitaliser le cœur creux d’un monde engourdi, inane et insane, raviver le verso solaire des rêves les plus imprévus, tels sont les objectifs de cette poésie qui, pour lucide qu’elle soit, s’entête à ne point renoncer à l’espérance.
Toujours revient le volcan en de multiples occurrences comme élément fondateur du paysage et symbole d’une psyché individuelle ou collective.
Bouche «ignivome», gueule pas tellement bien ourlée, museau (d’un volcan) inattentif, le volcan animalisé est assimilé à une menace de voration ou d’engloutissement. Figure sexuelle de la béance, il est ce lieu des profondeurs féminines dont l’activité garde, préserve, mais aussi expulse un corps neuf. C’est de là que montent la colère des peuples, la surtension atmosphérique, la giclée, le courroux de pierres, la suractivation des terres, le foyer, la mémoire, le sang. Autant de termes disséminés dans le recueil pour évoquer un jaillissement soudain de la vie-lumière qui rachète ou compense les lenteurs, les défaillances, les étiolements du flux salvateur. Ils sont signalés par «les oiseaux alourdis par le surcroît de cendre des volcans», les «volcans bègues», les «tribulations d’un volcan» « les retards d’îles éteintes et s’assoupis volcans».
Utérin lorsqu’il est question de ses «entrailles», le volcan se virilise dès lors que son énergie se manifeste. À vrai dire, il serait plutôt androgyne précisément parce qu’il témoigne des pulsions créatrices de la vie. Il cumule les fonctions de la gestation, de l’accouchement et de la fécondation. D’où la confiance du poète dans «l’énergie des cendres» et «la conspiration des cratères».
C’est tout ce que condense admirablement le poème intitulé «dorsale bossale». Le tire lui-même associe l’historique, l’anthropologique (bossale) au tellurique (dorsale). Les expressions complétives:
«qui vivent en meutes»
«dont la gueule émerge»
«véritables chiens de la mer»
«des volcans qui aboient»
«montant la garde»
assignent au volcan une action de vigilance, de gardiennage et de protection. Cependant, plus que du référentiel-objet c’est du volcan poétique dont il est question: celui qui ramasse de nuit les rancunes des peuples. Apparemment invisible, immatériel, il n’en est pas moins le plus actif et le plus dangereux.
Constamment, le poète rappelle sa relation étroite et cordiale avec le volcan. C’est lui qui marche sur la gueule des volcans. C’est lui qui se tient au pied de volcans bègues. C’est lui qui laisse (par dépit) fumer le volcan. C’est lui qui, dans une posture pascalienne («pour me distraire») voit le museau d’un volcan inattentif. C’est lui qui habille Miguel Angel Asturias de sa peau de volcan. C’est lui qui déclenche l’explosion et plante:
«sa parure de feu
son dolman de sang
son drapeau de rage et de renouveau».
Il en est, tour à tour, le compagnon impatient, le sorcier initié( à ses ruses et à ses masques), le metteur en scène inspiré et le messager fidèle.
L’image du feu se répand comme l’antidote du venin, de l’ombre, du ça, de la mangrove, de la poussière. Cette vertu curative explique que le «mot» soit assimilé au volcan ou au soleil.
«il y a aussi les capteurs solaires du
désir
de nuit je les braque: ce sont mots
que j’entasse dans mes réserves
et dont l’énergie est à dispenser
aux temps froids des peuples»
(sentiments et
ressentiments des mots)
À lire ce passage, il semble que les mots prennent une certaine autonomie par rapport au poète. Mots-minerais, mots-combustibles, mots calorifères, mots-tournesols que le poète prévoyant (pré-voyant?) entasse pour réchauffer les «temps froids des peuples». Ils ont leur énergie propre qu’il appartient au poète de dispenser. Poète condensateur puis redistributeur qui connaît le poids et le prix des attentes , leurs besoins et leurs remèdes.
Il peut sembler superflu d’insister sur la valeur que donne Césaire au mot. Néanmoins, il importe de revenir sur les traces du Cahier d’un retour au pays natal, œuvre fondatrice s’il en fut, pour mesurer le chemin parcouru et l’inflexion d’une pensée mouvante en dépit de la permanence de certaines structures irréductibles.
Souvenons nous des postulations initiales fixées dans une réflexion sur la poésie.
« La poésie est cette démarche qui par le mot, l’image, le mythe, l’amour et l’humour m’installe au cœur vivant de moi-même et du monde.»
(Extrait d’une communication d’Aimé Césaire au Congrès de philosophie de Port-au-Prince (Haïti) en 1944)
Souvenons nous.«Des mots?
Ah oui, des mots!»«Des mots? quand nous manions des quartiers de monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, des mots! mais des mots de sang frais, des mots qui sont des raz-de-marée et des érésipèles et des paludismes et des laves et des feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de villes…» (Cahier d’un retour au pays natal)
Il apparaît clairement que le mot, loin d’être une inertie figée, une simple enseigne informative ou une convention signifiante, exprime au plus haut une réalité qui relève de la création, dans et par le langage, d’un univers qui advient à l’être. Il est par conséquent doué d’une énergie, d’une puissance organique et en tant que tel, il participe, non pas de la formulation passive mais au contraire de l’instauration d’un ordre ou d’un désordre. Il traîne dans son sillage, le feu sacré des combustions et des communications. Il agit sur la matière, par lui convoquée, et libère des poussées d’en-dessous afin de faire surgir la vérité personnelle du poète.
Dans Moi, laminaire…, le mot n’est plus émergence tellurique du dire. Il ne prophétise point. Il appelle encore moins. Il est comme en dépôt dans le magasin d’un drame historique sur lequel descend le rideau d’une fin qui ne finit pas.
Il est nourriture «mes pains de mots» et élément d’une communion. Il énonce la fonction poétique «les ravisseurs du Mot».
Il perd de sa totalité «par quelques-uns des mots obsédant une torpeur» tout en témoignant d’un implicite refus.
Monstrueux, le mot animalisé détient les attributs d’une violence sacrificatoire:
«ils me reniflent et viennent
à l’heure
au lieu
à moi
pour être
s’y faisant un groin la griffe
le bec»
né des blessures de l’histoire il se fait guide. Chargé de tout le sacré, il accomplit de salutaires miracles en transcendant les obstacles et les menaces (caïmans/ désert/ squales). Rebelle, espiègle et familier, il joue à disparaître comme pour éprouver la foi du poète.
Les différentes formes du mot, ses diverses fonctions et ses multiples emplois (au sens théâtral du terme) préservent un pouvoir d’identification entre le dire et le nommé, le poète et la vie, l’être et sa représentation d’où le recours à des juxtapositions elliptiques qui signalent un raccourci, une vitesse, un éclat.
«le mot oiseau-tonnerre
le mot dragon du lac»
(sentiments et
ressentiments des mots)
«des mots bâton-de-nage», «mots Shango» «mot dauphin»
(mot-macumba)
Instrument, outil d’un voyage, toujours précaire, à travers le temps, le mot n’en est pas moins acte, intervention et mouvement. Il cristallise les données de la mémoire, les urgences de la révolte et la nécessité d’une purification du souillé et de l’impur, d’une réanimation de l’inerte et du figé.
La parole césairienne dans Moi, laminaire… s’entend non pas seulement dans le poème mais bien au-delà. Elle n’est que la pointe d’un corps absent (dans le texte) et présent (dans l’œuvre). C’est toute la vie antérieure qui donne sens à la murmuration d’une saisie rétrospective et presque nostalgique.
De cette manière, le recueil peut se lire comme une halte dans un parcours semé d’embûches et de défis relevés.
Derrière soi, le champ de bataille jonché d’armes miraculeuses, encombré de cadavres, rougi d’un sang immémorial. Devant soi, un combat à terminer malgré le poids des défaites (passagères), des illusions perdues et des usures inévitables.
En soi, le point nodal d’une intériorisation, d’une mise à distance, lorsque le soi se déprend de l’entour et du contexte pour s’éveiller à l’intime gravitation de la lucidité. Tout s’allège jusqu’au dépouillement et tout s’alourdit jusqu’à l’angoisse. Césure du moi (regardé et regardant), saisie réflexive du moi où s’insinue l’intuition d’une pureté, la rémanence d’un idéal et en même temps la conscience d’une finitude.
Ombres et lumières!
La figure métaphorique de l’ombre s’étend à l’absence de mouvement, aux signaux de la dévitalisation.
Le combat est mené contre:
«la torpeur des mornes»
«les haltes complaisantes»
«la vase commensale»
«l’hégémonie du brouillard»
«les villes somnambules»
«l’épaisseur de la nuit»
Tout un réseau sémantique est mobilisé pour stigmatiser la paralysie, la glaciation d’une mort en marche, «les temps froids des peuples».
Devant soi un combat pour la lumière.
Le soleil, feu central, anime symboliquement cette mise en scène manichéenne du Bien contre le Mal. Le «soleil vénérien» a fait place à son contraire: le soleil régénérateur, éveilleur d’aube, accoucheur de vie. C’est que l’un porte une valence historique ( le soleil dans le monde colonial) tandis que l’autre est happé par le champ de la métaphysique (soleil de la conscience).
Au sommet de la chaîne énergétique, le soleil ( comme le mot) dispense un courant jusqu’au plus bas en dynamisant de ce fait le tout de la création. Il éclaire la vision nostalgique dans laquelle se juxtaposent les fragments kaléidoscopiques d’un frère convertit en «feu sombre». Il se constitue en réserve «emmagasiné à l’envers du désastre». Garant d’un intouché, non encore contaminé par la décomposition du monde et du sens du monde, il illumine les «rêves» sur le point de s’éteindre ou de se tarir:
«pour raviver le verso solaire des rêves
leur laitance»
(pour dire…)
Saphir auquel s’identifie le poète (soleil safre), assimilé au cœur c’est dans le poème intitulé «pirate» que Césaire affirme et précise sa fonction et son fonctionnement.
Le poème pose d’entrée de jeu la question de la contribution du soleil à l’univers symbolique qui est le sien et conclut que le soleil «n’est pas là en intrus». Autrement dit, il atteste de sa présence légitime sans laquelle l’ordre serait tout autre. La série des «parfois» renvoie à des variations imprévisibles mais toujours signifiantes. Doté d’une véritable conscience, il manifeste des émotions, des états d’âme, des postures psychologiques qui vont de la colère à la mutilation en passant par la méditation. Il se confond avec le «fantôme» du poète, et par une logique inversée, avec sa force. Prédateur, «pirate» qui s’empare du butin (la vie?), il piège de mystérieux et d’insolites remords. Ceux, peut-être, qui naissent du sentiment de n’avoir pas achevé la tâche.
En tout état de cause, il y a une équivalence sinon une similitude profonde entre la condition du soleil et celle du poète et c’est de là que s’origine le questionnement initial. Tous les deux n’ont pas de raisons d’être évidentes et tous les deux déploient des stratégies qui justifient leur nécessaire présence. Ils donnent du sens à l’être. Ils rendent lisibles l’étant. Ils sont l’un et l’autre des manifestations d’une rhétorique au sens où l’entend Christian Prigent.
«Rhétorique est le nom d’une difficulté qui résiste à l’emportement du temps, à l’évanouissement désastreux des choses, des êtres, des pensées dans le temps. Rhétorique est le nom des techniques qui durcissent et qui font durer cette résistance.»
(A quoi bon encore des poètes?/ éditions P.O.L/1996)
Deux citations viennent renforcer cette approche.
«quand au Soleil, un Soleil de frontière
il cherche le poteau-mitan autour duquel faire tourner
pour qu’enfin l’avenir commenceces saisons insaisissables ce ciel sans cil et sans instance ce sang»
(sans instance ce sang)
N’est-ce pas là, sous le voile pudique de l’image, la définition de la mission que s’est donnée Aimé Césaire? Poursuivant dans le droit fil du Cahier d’un retour au pays natal qui voulait commencer «la fin du monde», le poète par une de ces intertextualités dont il est coutumier, postule la nécessité (contrariée) de commencer «l’avenir». L’un est le versant de l’autre. Liés, ces objectifs procèdent de la même démarche messianique: susciter la venue d’un monde (ou d’un rapport au monde) fondé sur d’autres valeurs universelles. C’est la dimension épique du projet qui engendre le doute, l’angoisse, la lassitude sans que pour autant la foi ne soit ébranlée. N’est-ce pas, récupérant un pouvoir divin, vouloir créer à nouveau un monde, mais un monde humain cette fois ci ? Evidemment, il manque le «poteau-mitan», l’axe, l’arbre d’une connaissance dont le secret n’a pas été livré aux hommes et qu’ils ont à charge d’inventer.
La saisissante image du
«soleil étourdiment distribué aux vers luisants
en brûlant en sang pur une attente incrédule»
(saccage)
associée au «saccage du grand cœur des saisons» suggère ce que j’ose appeler une erreur de casting. Il y a là l’évocation d’une déperdition, d’un émiettement, d’une impuissante gratuité d’un soleil/poète détourné de son essence.
La force du poète est de ne pas céder à l’appel des signes négatifs tout en les repérant parce qu’il les a éprouvés dans la lutte humaine, politique et poétique.
Malgré l’usure du temps et les pièges de l’histoire une colère est là et qui attend l’heure de sa délivrance. Le poète ne désespère pas. Il pense aux dragons (épactes…). Il salue le:
«guerrier-silex
vomi
par la gueule du serpent de la mangrove»
Il croit aux archanges du Grand Temps , au galop du petit cheval , au maillon de la cadène, à l’indubitable corps ou cœur sidéral , au mot père des saints , à la force des graines . Il attend la relance («la relance se fait algue laminaire»).
C’est cette foi, encore vivante, qui convoque dans Moi, laminaire… les éléments qui font contrepoids à la mangrove et à toutes les catégories du mou, du dilué, de l’englué.
Une monde de:
«forêts autonomes»
«pierreries»
«bambous»
«silex»
«obsidienne»
«arbres à hauts talons»
«chevaux»
«oiseaux parafoudres»
«pépite»
«pollens»
«pierre»
«graine»
«bec»
«aube d’os purs»
«couteaux de justice»
vient à la rescousse des manques et des faiblesses, des lenteurs et des décompositions pour que demeurent les volcans.
Vous l’aurez compris.
Les figures antagoniques:
Dur/mou
Soleil/ombre
Vitalité/inertie
Révolte/sommeil
Autour desquelles s’organise un réseau de sens induisent un discours non démissionnaire.
Est-il dédié à la seule Martinique? À l’évidence non! Loin d’être cantonnées à la Martinique les référents échappent le plus souvent à une domiciliation précise. D’une certaine façon, il y a une contradiction entre l’utilisation d’un vocabulaire extrêmement concret et la dimension abstraite du propos. Elle pose la question du destinataire de cette œuvre. A qui parle Aimé Césaire ? Non pas aux nègres, non pas aux damnés de la terre, non pas à l’homme blanc, non pas l’Afrique ou à l’Europe mais bel et bien à l’Histoire.
Aimé Césaire a entrevu et signifié, en utilisant les ressources de ses images, de ses symboles et de ses mots, tout un déséquilibre du monde. Si bien que Moi, laminaire… sonde les fractures, les dysfonctionnements résultant de ce séisme qui s’appelait colonialisme autrefois et qui aujourd’hui revêt le masque de la mondialisation. Avec une approche historique, philosophique, biblique , il montre et assume le frottement de l’être et du non-être afin qu’advienne, dictée par l’exigence éthique de la poésie, l’ordre de l’Ordre ( relié au principe du vivant) dont la meilleure structuration s’élabore au foyer de l’humanisme (le vrai !). C’est-à-dire, la haute conscience d’une responsabilité collective et totale envers l’ordre ou le désordre du monde compris comme partie d’un tout plus vaste, plus organique et plus vrai.
À cette condition, la justice écoutera aux portes de la Beauté et une nouvelle bonté ne cessera de croître à l’horizon.
Ainsi va Moi, laminaire… comme la reconstitution d’une équivalence entre le moi de la conscience poétique et le moi collectif de l’histoire. Rétrospection? Certainement! Rumination? Assurément! Mais aussi et surtout postulation généreuse, tension d’une quête qui pousse jusqu’à la métaphysique et relance d’une mémoire intacte dans le flux du Temps. Crète d’un chant ayant déjà annoncé la naissance du jour. Loin du cri , la trace, le graffiti , le fléchage, telles des balises pour indiquer la bonne passe.
![]()
