| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |
| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |
|
Mes coups de cœur en 2011 Hugues St. Fort
Corps mêlés, Marvin Victor • Ed. Gallimard • Janvier 2011 • |
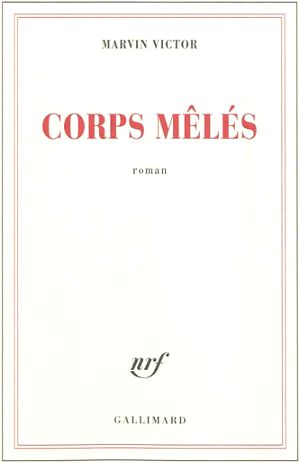 |
Ainsi que je le fais tous les ans depuis un certain temps, je présente dans ce texte une sélection commentée de dix des livres de fiction d’auteurs haïtiens que j’ai lus et aimés au cours de cette année. Une petite innovation cependant: pour la première fois, j’ai inclus dans ma liste un documentaire paru en DVD qui m’a tellement plu que je me suis senti obligé d’en parler.
J’espère que les lecteurs apprécieront cette intrusion d’un genre dont la nature semble le placer loin de l’objet livre mais qui relève aussi, d’une manière générale, de l’œuvre d’art. A ce titre, ce documentaire mérite de figurer dans ma liste commentée.
1. Marvin Victor
Corps mêlés, roman, Gallimard, 2011
Incontestablement, le favori de mes favoris. Corps mêlés est le premier roman de Marvin Victor, jeune écrivain haïtien de moins de trente ans. Il a frappé un coup de maitre avec ce texte remarquable d’originalité narrative, de hardiesse dans les créations d’images, et de puissance d’imagination. Pour sa première grande œuvre de fiction (le premier texte de Marvin Victor que j’ai lu est une courte histoire intitulée Blues for Irène parue dans Haïti Noir, l’excellent ouvrage collectif coordonné par la romancière Edwidge Danticat qui est sorti au début de cette année à New York), Marvin Victor nous livre un somptueux roman doté d’une force d’évocation stylistique rarement créée dans l’univers littéraire haïtien, mais en même temps, sans en avoir l’air, ce roman décortique le réel haïtien avant et après le séisme du 12 janvier 2010, le moment le plus tragique de l’histoire contemporaine haïtienne.
Ce n’est pas l’histoire qui intéresse dans Corps mêlés car ce roman ne raconte pas, strictement parlant, d’histoire. Corps mêlés est, en fait, un immense monologue tenu par la narratrice, Ursula Fanon, monologue qui fait se rejoindre le passé et le présent dans une suite zigzagante d’événements où on peine à se retrouver, à y entrer ou à s’en sortir tant la confusion temporelle vous écrase. Il y a pourtant quelques repères récurrents peut-être expressément mis par l’auteur: «le pays de Baie-de-Henne», qui figure au moins une centaine de fois dans tout le roman, l’éternel «sac en similicuir» que cite constamment la narratrice, la présence de sa marraine/tante tout à la fois sage-femme, «manbo», guérisseuse, et grande baiseuse devant les «lwa»; et surtout le cadavre de sa fille morte au cours du séisme qui surgit dans l’esprit d’Ursula Fanon telle qu’elle l’a vue, «son sang encore chaud, parfumé, mêlé à la poussière des gravats.»
Au-delà de la forte littérarité de son texte, Marvin Victor déploie dans Corps mêlés les parcours d’une analyse sociale qui atteint des niveaux de description particulièrement informatifs. Ursula Fanon, la narratrice, est restée, malgré ses trente années vécues dans la «grande ville», une petite paysanne consciente de ses limitations sociales dans un Port-au-Prince qui méprise les pauvres et les paysans. Elle en fait l’expérience dès son arrivée dans ce pensionnat pour jeunes filles fortunées, sorte de «prison dorée où la bourgeoisie de la haute-ville jetait ses brebis galeuses.» Depuis mon arrivée, aucune des filles ne m’avait adressé la parole, et, derrière les cloisons, j’entendais leurs rires, leurs chuchotements, le bruit feutré de leurs pas, les lentes mazurkas de Chopin qu’elles jouaient à tour de rôle au vieux piano Steinway du salon.
Si vous voulez offrir en cadeau de lecture pour les fêtes de fin d’année, un texte de fiction vraiment original et dont on parlera longtemps dans l’histoire littéraire haïtienne, je recommande passionnément le roman de Marvin Victor, Corps mêlés.
2. Yanick Lahens
Failles, récit, Sabine Wespieser, éditeur, 2010
Dans ce récit émouvant de bout en bout, Yanick Lahens, à partir du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, réfléchit sur l’acte d’écrire en Haïti, sur la faille géologique qui a provoqué le tremblement de terre, mais aussi sur les autres failles tout aussi destructrices qui minent la société haïtienne, la politique haïtienne, les rapports linguistiques haïtiens depuis de longues années. L’un des thèmes principaux que développe ce récit de Yanick Lahens est celui-ci: face à ce désastre qui frappe mortellement la société haïtienne, que peut la littérature? De quel pouvoir disposent les mots pour faire échec au malheur qui cette fois ne connait pas de limites? Comment l’écrivain va-t-il s’y prendre pour chasser le mal qui s’acharne sans répit sur cette société? Lahens écrit ceci: «Quels mots font le poids quand les entrailles d’une ville sont retournées, offertes aux mouches qui dansent dans la pestilence? Quels mots font le poids face à des hommes et des femmes têtus, forcenés de vie, qui dans la poussière et les gravats de la mort s’acharnent à réinventer la vie de leurs mains?» Et plus loin, elle dit: «Comment donner à la littérature sa part et sa part belle?» … «Face au malheur, comment faire littérature?»
Yanick Lahens va au-delà de l’aspect purement géologique que recouvre le signifié du mot «failles»: «cassure des couches terrestres accompagnées d’une dénivellation tectonique des blocs séparés» (pg.31). En fait, toute l’histoire de ce morceau d’ile dévoile des chaines de failles «que nous feignons d’ignorer, dit Lahens, alors qu’ [elles] constituent des chaines mortifères, qu’[elles] sont des lignes structurelles tout aussi meurtrières que les séismes.» (pg.32). Ces failles sont socio-économiques (et l’auteur en cite quelques-unes: «exode rural accéléré, paupérisation, dégradation de la production agricole et de l’environnement, chômage endémique», historiques (la fameuse dichotomie esclaves bossales vs esclaves créoles aux origines de la formation sociale haïtienne avancée par des chercheurs tels le sociologue Jean Casimir et l’anthropologue Gérard Barthélemy, et relayée par Lahens pour expliquer la douloureuse et obscène exclusion sociale qui ronge la société haïtienne depuis deux cents ans environ), linguistiques (l’ambiguïté de la situation linguistique de l’intellectuel haïtien devant faire face en Haïti à «l’exil de l’écriture dans une société encore orale, celui de la langue française et celui de la distance avec la culture populaire rurale et aujourd’hui urbaine.» (pg.130). Difficile de comprendre la profondeur de la catastrophe du 12 janvier sans passer par l’analyse de ces autres failles historiques, socio-économiques, linguistiques.
Vers la fin du récit, Yanick Lahens s’attaque à l’un des grands mythes qui circule dans le petit monde des intellectuels haïtiens et de quelques «amis d’Haïti»: «Haïti, un peuple qui souffre mais qui danse, chante, peint et écrit un français formidable» Courageusement, elle affirme au contraire que «la production artistique ne nous sauvera pas.» Et elle ajoute: «Le moment historique demande autre chose. Un projet de société. Une autre manière de faire de la politique, de produire, et de tisser de nouveaux rapports entre les gens. Il faudra sauvegarder le patrimoine et accompagner les artistes.»
Failles est une réflexion solide, personnelle, et intelligente sur le séisme du 12 janvier. Vous devez à tout prix lire ce texte. Si vous ne l’avez pas encore lu, vous êtes tout simplement impardonnable. Mais vous pouvez vous racheter car c’est la saison des Fêtes.
3. Louis-Philippe Dalembert
Noires blessures, roman, Mercure de France, 2011
Après la violence sauvage décrite dans le prologue de quatre pages de ce roman, le lecteur est plongé dans une histoire captivante du début jusqu’à la fin qui voit se croiser deux destins qui n’auraient jamais dû se rencontrer et qui vont connaitre leur dénouement au cœur de la jungle africaine. Louis-Philippe Dalembert fait alterner dans ce roman deux histoires, celle d’un Français expatrié, Laurent Kala, travaillant pour le compte d’une ONG dans un pays africain, et celle d’un jeune Africain pauvre, Mamad White, qui cherche à sortir de sa condition sociale en essayant tour à tour l’école, l’immigration clandestine, les petits jobs précaires… Au-delà des thématiques bien connues des ONG qui poussent comme des champignons dans les pays du Sud, et de la misère existentielle des habitants de ces pays, Louis-Philippe Dalembert décline le thème du signifié «noir» à travers toute l’histoire racontée dans ce roman: depuis le titre du livre, «Noires blessures» renforcé par trois citations de cette expression tirées de Ovide, dans Les Métamorphoses, Livre 1, tome 1, d’Eluard, dans La Vie immédiate et d’Alexandre Dumas, dans Le Vicomte de Bragelonne, tome VI, jusqu’aux personnages principaux de l’histoire. Mamad White est le jeune Noir africain qui cherche désespérément à échapper à sa condition précaire et qui échoue comme boy chez Laurent Kala, l’expatrié français. La situation de ce dernier est loin d’être enviable cependant car, depuis la mort de son père tué par un CRS noir au cours d’une manifestation de sympathisants blancs protestant devant l’ambassade américaine à Paris, le samedi 6 avril 1968, à la suite de l’assassinat du pasteur Martin Luther King Jr. à Memphis, dans le Tennessee, il est tourmenté par des névroses et des schizophrénies affectives qui lui font voir l’assassin de son père dans tous les Noirs qui traversent son chemin. Soupçonnant Mamad White de voler de la nourriture pour aider sa nombreuse famille, il le surprend un jour avec une jeune femme noire et l’enferme dans la maison pour lui administrer une brutale correction pendant trois jours. Pourtant, malgré son horreur des Noirs, il ne put s’empêcher d’adopter un petit garçon noir dont le «sourire le rendait si heureux» et dont «il avait changé le prénom donné par les parents naturels».
Dans ce roman, deux narrateurs se partagent l’espace narratif: l’un est Noir, Africain et pauvre; l’autre est Blanc, Européen et de classe sociale moyenne. Ils décrivent avec un réalisme remarquable non seulement leur condition sociale, mais aussi et surtout leurs émotions, leurs angoisses, leurs obsessions, leurs névroses. L’expression du sentiment attraction/répulsion qu’éprouve Laurent Kala, le narrateur européen, à l’égard des Noirs depuis le meurtre accidentel de son père par un CRS noir relève d’un cas pathologique qui a failli faire de lui un meurtrier. Dalembert sait raconter une histoire et possède l’art de «se projeter dans des identités de rechange» (Dominique Fernandez). De plus, son écriture peut changer de registre avec une facilité admirable. Dans Noires blessures, que je recommande intensément, il est au sommet de son art.
4. Frantz Voltaire
Manno Charlemagne, Konviksyon, DVD, Pwodiksyon: CIDIHCA ak Fred Paul, Kreyòl, 2010, 58.30 min.
Avec ce DVD, Frantz Voltaire qui a déjà réalisé les documentaires Port-au-Prince ma ville, Les chemins de la Mémoire et Maestro Issa, raconte la vie et l’œuvre d’Emmanuel (Manno) Charlemagne, l’une des icônes de la musique populaire haïtienne des années 1970-1980 qui allait réveiller la conscience politique de toute une génération et contribuer à faire avancer l’histoire d’Haïti. L’auteur-compositeur nous fait revivre ses origines populaires, l’influence d’une mère passionnée de musique traditionnelle haïtienne et de culture folklorique qui l’a involontairement entrainé à écouter ces types de musique. Parmi les chanteurs qui ont marqué son enfance, il cite Guy Durosiers, Pierre Blain, Gérard Dupervil, Anilus Cadet, le chantre des «lumpen» (se gwo zòtèy nou ye) de Daniel Fignolé dans les années 1950. La musique a joué aussi un grand rôle dans l’éveil de sa conscience politique. Gérard Dupervil et Raoul Guillaume, en particulier, ont contribué, à travers des chansons symboliquement osées, à ouvrir ses yeux à la réalité répressive dominante sous le dictateur François Duvalier et ses «tonton makout». Il n’oublie pas d’adresser un coup de chapeau à Toto Bissainthe, la passionaria de la cause haïtienne, pour «Dèy», son chef-d’œuvre et à Louis Armstrong qu’il découvre en Haïti, déversant des sons proches de borborygmes auxquels il ne comprend bien sûr rien mais qu’il apprend à adorer en l’écoutant des dizaines de fois.
Toutes ces influences ont contribué à son engagement politique car, dit-il, il a refusé l’avenir de «jandam» qui lui était destiné en tant qu’adolescent grandissant d’abord dans le quartier de «Granri» puis à «Kafou».
Vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, profitant de l’ouverture accordée par le régime du dictateur Jean-Claude Duvalier sous la pression politique de l’administration du président américain Jimmy Carter, Manno Charlemagne entreprend avec la complicité de son copain Mako (Manno e Mako) à établir les bases de sa propre interprétation de «l’ouverture culturelle» avec des chansons qui attaquent la réalité politique et sociale ainsi que l’ambivalence culturelle haïtienne. Frantz Benjamin lui donne sa chance en le faisant passer à Radio Métropole qui était à l’époque le haut-lieu des médias chics avec son complice Mako, puis, il est lancé par Jean Dominique à Radio Haïti. Il ne manque pas de souligner ses dettes à l’égard de Lyonel Trouillot, l’auteur des paroles de la célèbre chanson «Pou ki», qui, dit-il, lui a appris à poser des questions ; il découvre le philosophe italien Antonio Gramsci et sa fameuse théorie de l’état, de la société civile et de la bourgeoisie ; il se positionne résolument contre l’idéologie néfaste du noirisme, l’une des plaies de la société haïtienne, que certains tentent de ressusciter de temps en temps.
Le documentaire regorge d’images inoubliables à valeur historique, culturelle, ou architecturale. Frantz Voltaire révèle son métier et tout son talent de documentariste (avec la complicité de son monteur Jean-François Chalut), et tout au long du film alterne les réminiscences de Manno avec les performances des musiques évoquées ou les images des personnages mentionnés. Le film s’achève avec un morceau d’ironie: on voit Manno Charlemagne chantant sur des images de fin des années 1980 son refrain entrainant et bien connu: «Michèle Bennett, I’m sorry for you, se lan videyo w a wè foto peyi dayiti…» alors qu’on se souvient qu’il y a encore quelques mois, en janvier 2011, l’ex-mari de Michèle Bennett, le dictateur Jean-Claude Duvalier, est rentré au pays sans être inquiété et qu’elle-même est venue en Haïti récemment narguer ce peuple qui l’avait chassée en 1986. Haïti, le pays où l’Histoire continue de bégayer!
5. Edwidge Danticat (ed.)
Haiti Noir, nouvelles, Akashic Books, NY, 2011
Je ne suis pas sûr qu’il existe avant cette anthologie coordonnée par Edwidge Danticat une tradition de roman noir haïtien. Tout au plus, il me semble qu’il y a eu un ou deux écrivains qui se sont essayés au polar et qui y ont connu un certain succès. Je pense à Gary Victor par exemple dans son polar Nuit albinos et, plus loin dans le temps, à l’écrivain Raymond Philoctète qui avait l’habitude de publier des histoires de détective haïtien dans les colonnes du quotidien Le Nouvelliste au début des années 1970, je crois. Pour cette anthologie, Danticat a fait appel à des écrivains haïtiens confirmés tels Louis-Philippe Dalembert, Yanick Lahens, Josaphat-Robert Large, Gary Victor, Kettly Mars, Rodney Saint-Eloi, à côté d’autres moins bien connus, comme Marie-Lily Cérat (dont le texte, Maloulou, est une petite perle), Marvin Victor (dont j’ai dit ici tout le bien que je pense de son premier roman «Corps mêlés», Ibi Aanu Zoboi, Nadine Pinède et deux écrivains américains, Mark Kurlansky et Madison Smartt Bell. Danticat elle-même a fourni une contribution intitulée Claire of the Sea Light.
Le livre est divisé en trois parties qui comprennent chacune six nouvelles. La première partie intitulée «Which Noir» essaie d’établir les frontières du Noir dans le milieu haïtien. La deuxième partie intitulée «Noir Crossroads» est, à mon avis, la plus représentative du livre. La troisième partie est intitulée «Who is that Noir?»
Edwidge Danticat en tant que coordonnateur du projet Haïti Noir a voulu adapter le roman noir et ses principes occidentaux aux particularités du mystère et du crime telles qu’elles sont connues dans le milieu haïtien et qui combinent sorcellerie, superstition, actes gratuits de violence… Il est hors de doute qu’elle a pleinement réussi et que tous les écrivains qu’elle a réunis ont bien rempli leur mission. Pour moi, admirateur inconditionnel de l’œuvre littéraire d’Edwidge Danticat, c’est une autre occasion de célébrer avec raison ce superbe écrivain haïtien. Je vous engage à faire de même.
6. Lyonel Trouillot
La belle amour humaine, roman, Actes Sud, 2011
Dans la recension que j’ai faite ici même de ce roman de Lyonel Trouillot, j’ai interprété le livre comme un grand texte philosophique où l’auteur pose certaines questions fondamentales de l’existence humaine: «Qu’est-ce que la vie?», «Quel usage faut-il faire de sa présence au monde?», «Est-ce jamais un crime de produire du bonheur?», «Contre quoi peut-on encore se révolter?» En fait, le titre du roman peut inciter à le lire de cette façon. Trouillot lui-même signale qu’il a choisi ce titre en référence à un message de vœux que le romancier haïtien Jacques Stephen Alexis a publié en janvier 1957 dans Les Lettres françaises, ce qui peut sous-entendre une démarche tournée vers la compréhension humaine, la recherche du bonheur, l’élimination du mal.
Tout le roman de Trouillot consiste en un long monologue tenu par les deux narrateurs, Thomas et Anaïse. Anaïse est une jeune Européenne qui va en Haïti pour en savoir plus sur son père qui a disparu quand elle était très jeune. Dans la voiture qui la conduit vers ce petit village côtier où il a vécu dans le temps, elle entame une longue route de sept heures avec son guide haïtien qui lui raconte l’énigme de la disparition de son grand-père au cours d’un mystérieux incendie. Sur le chemin du retour, c’est au tour d’Anaïse de parler et elle se met à raconter ce qu’elle s’imagine avoir été les derniers moments de son père, «ses mots», «ses rêves», «la mémoire de son silence». Le gros du récit que Thomas fait à Anaïse sur la route se rapporte au grand-père de cette dernière et de son grand ami le colonel. Le grand-père est Robert Montès, un homme d’affaires mulâtre, et son grand ami est un colonel à la retraite, Pierre André Pierre. Avec ces deux personnages, Lyonel Trouillot dresse jusqu’à la caricature (leurs noms, leurs origines sociales, la couleur de leur peau, leurs conduites et leurs comportements…) le portrait de deux représentants des deux catégories sociales qui ont dominé l’histoire politique, culturelle, et socio-économique d’Haïti depuis au moins le milieu du dix-neuvième siècle, c’est-à-dire, selon l’auteur, les «noiristes et mulâtristes, ‘nationaux’ et ‘libéraux’, aristocratie terrienne et bourgeoisie de comptoir, héritiers et self-made men.»
Ce roman de Lyonel Trouillot est arrivé dans le dernier carré de la sélection du Goncourt et a failli obtenir le prestigieux prix littéraire français. Rien que pour cela il mérite votre intérêt.
7. Robert Berrouet-Oriol
Poème du décours, poésie, Triptyque, 2010
Ce recueil de poèmes a permis à Robert Berrouet-Oriol d’être sacré lauréat dans la catégorie poésie au Salon du Livre Insulaire de Ouessant (Bretagne) en 2010. Berrouet-Oriol n’est pas un nouveau venu dans la poésie haïtienne d’expression française. En 2009, il a publié En haute rumeur des siècles, aux éditions Triptyque, et en 2008, Troc paroles/ troc de paraules. Sa poésie est très exigeante et accorde au signifiant une place prépondérante dans l’ensemble de la création verbale. Poème du décours est un long poème en prose qui «interpelle la figure emblématique d’Angélique, esclave noire et rebelle qui, en 1734, fut accusée et pendue pour avoir incendié Montréal.» L’ampleur de la prose poétique de Berrouet-Oriol suggère que le poète a réussi à «trouver le point de contact entre le vers et la prose». En témoignent ces passages: «j’ai tiré ma révérence en trait de fusain contre les lèvres du jour ne m’attends plus sur ce boulevard aux pieds borgnes épuisé d’avoir trop compté mes maux j’ai fait vœu de marcher désormais à côté de mes pas à l’aune même de l’ile que je porte dans ma tête on y accède par chemins de patience aucun pont ne la relie aux glaciers qui l’entourent… (pg. 55).
8. Louis-Philippe Dalembert
Transhumances, poésie, Arpents Riveneuve éditions, 2010
Le romancier Louis-Philippe Dalembert retourne avec ce recueil à ses premières amours, la poésie (ses premiers textes littéraires concernent la poésie: Evangile pour les miens, 1982; Et le soleil se souvient (suivi de) Pages cendres et palmes d’aube, 1989; Du temps et d’autres nostalgies, 1995 et il est évident que son talent de poète est resté intact. Transhumances contient une quinzaine de poèmes qui traitent des thématiques chères à Dalembert: l’errance, qu’il élève à un statut universel; Haïti, dont il dit dans le poème «on my mind haiti» dédié à Edwidge Danticat, ceci:
On ne quitte pas ce pays
On ne le quitte pas
Ni même ne s’en va
l’absence douloureuse de son père qu’il célèbre dans le poème je n’ai jamais dit papa (pgs 85-87) et qui est peut-être le plus poignant de tout le recueil par sa sincérité et la sensibilité toute virile qui s’en dégage
je n’ai jamais dit papa
et ne le dirai jamais
je n’ai aujourd’hui
plus honte de le dire
le temps a passé
où je serrais mon absence
dans les replis
de ma gêne
de ma pudeur vaste et sèche
comme une étreinte paternelle
Tous les poèmes de ce recueil portent les dates et le lieu où ils ont été conçus: à Paris, Jacmel, Rome, Liège, Sarajevo…Louis-Philippe Dalembert se définit comme un «vagabond» parce qu’il a roulé sa bosse pratiquement partout. L’un des poèmes du recueil porte d’ailleurs ce titre «vagabondage» avec la citation de deux vers d’une célèbre chanson de Georges Moustaki:
«Quand elle est au creux de mon lit
elle prend toute la place.»
Le pronom «elle» dans la chanson de Moustaki se réfère à la solitude et l’on comprend alors que l’errance et le vagabondage du poète n’ont jamais été consentis de gaieté de cœur. Il y a quelque chose de plus profond que cherche le poète et qu’il exprime dans le long poème intitulé «l’étranger en marche sur la terre» qui ouvre le recueil:
en route sur la terre
l’étranger creuse sillon d’azur
dans la foulée du rêve
creuse sillon de lumière
vers son chemin parsemé d’étoiles
et d’hirondelles
9. Jean-Euphèle Milcé
Les jardins naissent, roman, Coups de tête, 2011
Je connais mal l’œuvre littéraire de Jean-Euphèle Milcé. En fait, Les jardins naissent se trouve être le premier texte de fiction que j’ai lu de cet écrivain, actuel président du Pen Club Haïti. Bien m’en a pris. Ce petit livre (il ne fait que 120 pages) possède un charme particulier dans l’écriture et dans le projet de l’auteur. Il raconte l’histoire de Daniel et de Marianne. Daniel est un jeune artiste haïtien qui a voulu prendre racines au Canada après que son visa est arrivé à son terme. Il a donc été déporté à Port-au-Prince. Marianne est une jeune Française, fonctionnaire au Comité international de la Croix Rouge (CICR) qui s’est pris d’amitié laquelle évoluera en amour pour Daniel, évadé de prison à l’occasion du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le rythme du roman est rapide et l’histoire file à toute vitesse. Daniel et sa petite bande d’exaltés qu’on assimile à un gang puissant et méchant conçoivent le projet fou de couvrir la ville à moitié détruite de plantes et de jardins de toute sorte.
La narratrice qui raconte l’histoire oscille entre l’intime et l’engagement aux côtés de ceux qui n’ont rien dans le Port-au-Prince de l’après-séisme. Le problème que pose l’auteur est celui-ci: «Comment peut-on proposer de reconstruire sur du sol mou, fragile, inondable, des gros bâtiments pour faire semblant de gouverner et de faire du commerce. La ville est trop vulnérable. Il faut écouter ses besoins. Port-au-Prince, c’est une histoire d’eaux en furie à chaque petite pluie, d’inondations régulières, de toitures arrachées par des vents fous, de quartiers détruits par le feu parti d’un jeu d’enfant, de camions sans phares et sans freins, de robinets secs. L’espace soumis à toutes les menaces possibles et permises à l’imagination.» Ceux qui gouvernent Haïti ont-ils jamais réfléchi à ces interrogations?
10. Emmelie Prophète
Le reste du temps, roman, Mémoire d’encrier, 2010
Dans son premier et inoubliable récit, Le testament des solitudes, qui était sorti chez Mémoire d’encrier en 2007, Emmelie Prophète avait, à travers une authentique écriture féminine, résumé l’écoulement de l’existence de trois générations de femmes qui toutes ont connu des illusions de vie et qui ont vécu la misère de la solitude. Avec Le reste du temps, Prophète passe à un autre registre. Le roman débute le lundi 3 avril 2000, le jour de l’assassinat du célèbre journaliste haïtien Jean Dominique. La narratrice, professeure dans le secondaire, vient d’apprendre la nouvelle de la bouche de la directrice de l’établissement où elle enseigne et elle est déchirée. Les premières pages du livre racontent son désespoir, sa tristesse infinie à l’hôpital où repose le cadavre de Jean Dominique, le souvenir de Jean-Claude, le gardien de l’immeuble de Radio Haïti qui avait été assassiné en même temps que le journaliste. La narratrice s’attarde quelque temps à s’interroger sur le destin de Jean-Claude à propos duquel elle dit «Je n’aurais jamais connu son nom de famille s’il n’avait pas été assassiné. Il serait parti comme il était venu. Il était de ceux qui n’existent pas, comme il y en a beaucoup ici.»
Les descriptions que donne Emmelie Prophète de Port-au-Prince vers les années 1991-1994 sous la répression sanguinaire des militaires auteurs du coup d’état sont terrifiantes: «Les trottoirs de notre ville certains matins étaient des lits étranges où se reposaient des corps troués. Yeux exorbités. Bouches ouvertes comme voulant prononcer un dernier mot. De la viande et du sang pour les mouches. Du spectacle pour les chômeurs qui venaient à loisir regarder pendant les longues heures le cadavre resté sur le trottoir.»
Grâce à de tels passages, le roman d’Emmelie Prophète justifie l’une des tendances actuelles de la recherche à considérer la littérature (surtout le roman) comme «une source privilégiée de connaissance et d’imagination pour les sciences sociales» (Barrère et Martuccelli 2009). Qu’est-ce qui fait le charme de ce livre au titre si banal qu’il est loin de relever du littéraire? D’abord, la poésie qui se dégage de chaque page, de chaque ligne. La narratrice nous en donne à partir de rien, de la pluie, de sa fille qui dort, des humeurs de Jean, du souvenir de Jean-Claude, le gardien d’immeuble assassiné avec Dominique. Ensuite, du portrait atypique de la société haïtienne qu’on en retient. Et puis, l’immense sensibilité de l’écrivain, faussement naïve dans ses réflexions sur la société haïtienne, amoureuse sans ride de la littérature et surtout passionnée de la grande mangeuse de notre réalité invisible, le temps.
![]()
