|
Travaux
du GEREC-F
|
|
|
|
L’ELOGE DE LA MUETTE 1
|
|
par Jacques COURSIL
GEREC-GIL UAG |
| En fin de compte,
utilisant un vieux proverbe de plus, je déclare qu’on a raison de se louer quand on ne trouve personne pour le faire. (Eloge de la folie, Erasme) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre richesse bilingue refusée se maintint en douleur diglossique. (Eloge de la Créolité, Bernabé, Chamoiseau, Confiant) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommaire«Texaco»
ou le roman de la muette qui parle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | il n’y en a pas |
français | |
| 2. | il n’y a pas |
chute du pronom clitique (en) |
français créolisé |
De manière plus subtile, le vendeur ou la vendeuse peut, à la fin de vos achats, vous poser l’une des deux questions suivantes, où la prosodie est différenciée par la chute d’une pause:
| 3. | C’est tout, pour
vous? |
pause après tout
|
français |
| 4. | C’est tout pour
vous? |
chute de la pause |
français créolisé |
Les cas de francisation du créole sont encore plus fréquents en ce qu’ils sont portés par des pratiques langagières qui conduisent souvent à commencer une phrase dans une langue et pour la finir dans l’autre. Ainsi, les langues sont distinctes, mais les paroles souvent les confondent.
D’une manière générale, l’unilinguisme n’est la règle que dans l’exception, notamment dans certains pays développés, car partout ailleurs dans le monde, de gré (et parfois de force), les peuples sont multilingues. Pour les lieux dont nous parlons ici, français et créole sont toutes deux des langues maternelles sinon fraternelles. Cette «maternalisation» des langues est une identification sociale et non pas familiaire. Au regard de l’acquisition du langage, c’est tout le groupe social qui se penche au dessus des berceaux. Au regard de l’apprentissage des langues (cas différent), elles sont dites «maternelles, secondes ou étrangères». Le français aux Antilles est-il langue «maternelle» ou «seconde»? «Etrangère» en tout cas semble hors de propos.
Quoi qu’il en soit, deux langues distinctes dans une société donnée remplissent toujours des fonctions sociales et institutionnelles différenciées. Ces sphères d’emploi peuvent être d’une extrême subtilité. Selon le rang, le sexe, le degré d’intimité, la circonstance, les lieux, le degré d’estime dans lequel on tient l’autre, ou le degré d’estime dans lequel on estime que l’autre vous tient, (la place qu’on tient dans le coeur de l’autre ne vous convient pas toujours), il faut savoir quand une des deux langues devient inconvenante. Dans l’urbanité martiniquaise (ce n’est pas vrai en Guadeloupe), c’est plus souvent qu’à son tour que le créole n’est pas de mise. Une simple compétence linguistique en cette langue n’assure nullement une performance correcte. C’est pourquoi le refoulement du créole en pays créolophone est un des thèmes forts de l’Eloge.
«Face aux tournures du créole, un hoquet de dégout lui bouleversait le corps. «Mon Dieu, ..., cette langue est sale, elle détruit Haïti et conforte son analphabétisme. C’est la dessus que Duvallier et les Tonton-Macoutes bâtissent leur dictature. L’universel, pensez à l’universel.» (Texaco Chamoiseau)
Mais tout ceci n’est qu’apparence. Le créole, souvent muet, est toujours présent sous l’autre langue. Investissant le signifiant de la langue-qui-parle (Fr), la langue créole, «forclose» c’est-à-dire inscrite dans les coupures de l’autre langue, continue son jeu et représente le sujet parlant.
Cri
Dans nos pays, les langues sont liées à leur destin de ne pourvoir exister l’une sans l’autre, la muette criant sous l’autre qui parle. Ainsi, la Créolité est une identité divisée et le créole, le cri muet assourdissant de tous les discours. Mais il faut noter une différence, somme toute assez subtile: en créole, le «cri» est dans la langue alors qu’en français il est hors la langue: crier n’est pas parler. En créole par contre, «krié» veut dire «nommer», «appeler», etc. «kri» est une racine transitive qui commande tout le paradigme phatique.
| 5. | comment appelles-tu ça? | kouman ou ka kriyé sa? |
| 6. | comment t’appelles-tu? | ki mannyé yo ka kriyé’w? |
| 7. | je t’appellerai au téléphone | man ké kriyé’w au téléfon-la |
| 8. | il m’a traité d’enfant de salaud | i kriyé mwen isalop |
C’est donc la muette qui nomme puisse qu’elle crie, mais les mots lui manquent et l’autre langue lui coupe la parole
François, langue coupée
Certains disent que la langue française est elle même un «créole du latin» voulant ainsi signifier qu’en matière de langue, on est toujours le «créole» d’un autre. Ce n’est qu’une image, au demeurant fort inexacte linguistiquement; inexacte car «créole» est un nom-propre qui désigne une langue alors que «créole de» est un nom relationnel qui comme «dialecte de» ne désigne pas une langue, mais le pidgin d’une autre. Quoi qu’il en soit, on sait qu’entre 1539 (Ordonnance de Villers-Cotterêt) et 1549 (Défense et Illustration de Du Bellay) la langue française change d’être politique. Les catégories signifiantes du «françois», langue vulgaire, prennent désormais le statut officiel de catégories de pensée: la langue «françoise» accède au discours. Au début, cela ne va pas sans la nécessité de quelques éclaircissements ne fût-ce que pour convaincre quelques incrédules qui, dans ce françois si «rude et mal sonant», y perdent leur latin. Dans sa «Défense et Illustration de la langue françoise», Du Bellay écrit contre les détracteurs de la langue vulgaire:
«Nous (les parlants françois) ne vomissons pas nos paroles de l’estomac comme les ivrognes, nous ne les étranglons pas dans la gorge comme grenouilles, nous ne les découpons pas dedans le palais comme les oiseaux, nous ne les sifflons pas des lèvres comme serpents. Si en telles manières de parler gît la douceur des langues, je confesse que la nostre est rude et mal sonante. Mais aussi avons nous cet avantage de ne tordre point la bouche comme des singes, voire comme beaucoup, mal se souvenant de Minerve qui jouant quelquefois de la flûte, et voyant en un miroir la difformité de ses lèvres, la jeta bien loin, malheureuse encontre au présomptueux Marsyas qui depuis en fut écorché.» (J. du Bellay Défense et Illustration de la langue française)
Un siècle à peine sépare la naissance du créole de celle du françois comme langue de pensée, ce qui est peu à l’échelle des langues. A cette époque de chocs des mondes, les Français patoisent encore beaucoup et partout, néanmoins leur langue est là.
Le triomphe de ce «françois» sur le latin n’est pas célébré au delà de 1605 car «Enfin Malherbe vint (sans oublier Vaugelas) et, comme on dit pour la poésie, les catégories signifiantes du françois s’en allèrent». Dans ce raccourci d’histoire littéraire qui n’oublie pas Descartes, le premier a traiter de philosophie en langue vulgaire, la langue désormais classique plonge enfin ce rude et libre françois sous la «juste cadence» et la «droite raison» des catégories du logos universel. Sous cette langue classique si transparente en ses sommets va s’effectuer la forclusion2 des catégories signifiantes du françois, classé aujourd’hui «Moyen-français». Sous ces catégories universelles qui, par mimésis, sont celles qu’Aristote a prises aux catégories signifiantes de la langue grecque, le françois devient une langue muette sous sa propre transformation. Ainsi la langue de Montaigne, d’Aymiot, d’Ambroise Paré, la langue de Du Bellay, de Rabelais et de Blaise de Montluc, subit elle aussi la forclusion sous les catégories du logos classique: « françois, langue coupée». Ainsi, pour notre propos, on notera qu’une langue muette (créole) se trouve recouverte par une autre (françois) qui l’est presqu’autant. Il semble donc qu’en matière de guerre des langues, les stratégies diachroniques aiment à se répéter.
Quand on descend, de sommets en sommets, le fil de l’histoire des Belles-Lettres, on aboutit en contrebas des grands parnasses à des parnasses plus petits où l’amour de la formule l’emporte sur celui de la langue. Dans ces parnasses jacobins, on retrouve les personnages lettrés de «Texaco» (Ti-Cirique, Alcibiade) répliques de tous les mulâtres saint-simoniens de la Caraïbe francophone.
«Dans sa bouche, ..., la langue française semblait infinie et chaque mot entraînait des dizaines et des dizaines de mots avec un allant de rivière dévalante»
Dans cette esthétique démodée et tenace, témoin des beaux fleurons de l’éloquence française en pays créolophones, les trois canons académiques, le beau, la grâce, le sublime, se moulent avec humour sur les formes de la langue muette:
«A écrire, l’on m’eût vu le crayon noble, pointant moult élégantes, de dignes messieurs, l’Olympe du sentiment; l’on m’eût vu Universel, élevé à l’oxygène des horizons, exaltant d’un français plus français que celui des français, les profondeurs de l’homme, de la mort, de l’amour, de Dieu; mais nullement comme tu le fais, encossé dans les nègreries de ta Créolité ou dans le fibrociment décrépi des murs de Texaco.»
En fait, toute littérature remet en question l’adage des linguistes selon lequel pour parler, une langue suffit. Sous la langue de Chamoiseau (mais aussi sous celle de Confiant, son compère) le signifiant créole restitue en écho l’éclat, la verve, la finesse et la rudesse d’un signifiant «françois» perdu. Le tabou est transgressé: la muette a fait parler l’autre.
Diglossie
Mises à plat, les langues en contact se disposent par recouvrements partiels. Ainsi représentées, deux langues, systèmes synchrones, définissent une intersection, notée «lemniscate», qui marque l’espace de leur dialectalisation réciproque.
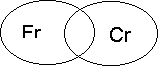 |
intersection en lemniscate |
Ces interférences de langues sont des processus intersystémiques. L’idée socio-génétique selon laquelle une langue nouvelle (le martiniquais) pourrait apparaître dans l’interlangue définit par le lemniscate est défendue par le linguiste F.L. Prudent (1993). En effet, l’intersection de deux systèmes synchrones (Fr & Cr) traçant les contours d’un espace linguistique asynchrone en gestation s’apparente à un modèle idéal de formation des langues. Certes, les langues naissent des langues et de leur commotion. Néanmoins, ce modèle socio-génétique élégant est quelque peu réducteur car d’une part, son idéalité conceptuelle ne prend pas en compte les facteurs de complexité de toute théorie des systèmes traitant de l’organisation progressive d’un chaos et d’autre part, en inversant la méthode historique qui consiste à constater des faits accomplis, il tombe dans le fantasme du linguiste, témoin oculaire (voire prophète) de la naissance d’une langue. Le filage de la métaphore génétique appliquée aux langues naturelles dénote une erreur épistémologique doublée d’une erreur de proportion car la diachronie des langues s’effectue sans déterminisme historique et se meut avec une «immense lenteur», hors de portée d’un individu et de ses capacités d’interprétation des faits observés. Par leur double dynamisme historique et systémique, toutes les communautés multilingues de la planète sont, par définition, des lieux de diglossie, sans pour autant, à chaque fois, donner mécaniquement naissance à des langues nouvelles. Ce déterminisme de l’émergence observable est dû à un contre-effet du mode de représentation adopté, mode qui consiste à penser que les «sujets parlants sont inscrits dans les langues». La réalité est toute autre: ce sont les «langues qui sont inscrites dans les sujets» (ce que soutiennent de manière diverse tous les grands programmes linguistes de ce siècle de Saussure à Chomsky). Inscrites dans chaque membre des communautés qui les parlent, les langues vivent leur conflit non dans une dimension topographique collective, mais dans une dimension psychique individualisante. Les langues française et créole, sphères distinctes de catégories signifiantes, ne sont pas disposées à plat philologiquement comme des langues mortes, mais sont inscrites diglossivement dans chaque sujet.
Le français créolisé et le créole francisé sont des exemples de commotion de langues dans un même sujet. Cette commotion est douloureuse; c’est une glossalgie, une douleur muette de langage.
La dialectisation des philologues s’effectue entre les langues, mais la diglossie se forme dans chaque sujet. Ainsi, la relation des langues ne s’effectue pas sur le modèle d’une intersection structurale, mais avons-nous dit d’une forclusion, c’est-à-dire d’un refoulement.
L’individu se constitue sujet dans et par la langue. La diglossie créole est un cas particulièrement clair d’identification du sujet à sa langue précisément parce que c’est une identification manquée. Le sujet parle en français, mais son identification est créole. Tel est le cri de la muette.
La méthode structuraliste, faussement attribuée à Saussure, a vieilli. Le signifiant n’est pas, comme on le croit, un simple marqueur appartenant au monde sensible; il dépend d’une sémiologie, c’est-à-dire d’une théorie des actes. «Système signifiant» veut dire activité psychique de transfert via des entités négatives que le sujet doit effectuer. Ainsi, le signifiant, entité négative et complexe, ne relève pas d’une dimension ontologique interprétative, mais d’une dimension ontique, c’est-à-dire d’une expérience de transfert.
Les structuralistes observent le langage, la méthode analytique de Saussure en propose des modèles d’expérience, modèles dont la diglossie constitue à contrario un exemple de dysfonctionnement. Ainsi, le sujet est la topique des langues et de leur conflit. C’est dans chaque sujet que s’effectue la commotion des langues.
Le symptôme diglossique consiste à ne pas lâcher prise fut-ce au prix d’une «catastrophe» sémiologique. Le sujet identifié en créole s’accroche à sa langue quand il parle en français, (c’est normal quand on apprend une langue étrangère, mais c’est la marque d’un trouble quand on connaît les deux langues). Cette diglossie est un symptôme transférentiel d’un sujet qui pour dire la pensée dans sa langue d’identification est contraint de transiter par une autre.
La diglossie est un trouble qui masque la coupure et annihile la distinction signifiante des langues. C’est une stratégie qu’applique le sujet pour éviter la partition de l’être et celle du pensable. Pris dans une langue, il ne peut pas lâcher l’autre. Pour masquer la coupure des langues, il sémiotise un lien entre elles: c’est le prix qu’il paie pour rester «un». Cette disposition n’est pas en soi particulière ni grave ni d’ailleurs évitable: elle est même inhérente à tous les multilinguismes. A l’échelle phonique, elle est tout-à-fait naturelle. La phonologie d’une langue s’énonce parfaitement sous la phonétique d’une autre: on peut parler correctement le portugais avec l’accent russe et le français avec l’accent créole. La diglossie ne s’aggrave qu’aux échelles morpholexicales, syntaxiques et prosodiques. Mais quelque soit son degré, le syndrome diglossique suit le même schéma de résistance à cette division du sujet qu’implique la distinction des langues.
Le refoulement du signifiant d’une langue sous un autre d’une autre langue ne peut pas se représenter spatialement ni linéairement sans tomber dans une «psychologie des profondeurs». Les langues, comme tous les systèmes symboliques, ne participent pas de la dimension spatiale: la muette n’est pas «dans» ni «dessous», mais habite littéralement les coupures de l’autre; c’est ce que «refoulement» veut dire ici.
Diglossie dialogique
Contrairement à toute attente, la diglossie n’est ni collective ni strictement individuelle. C’est un symptôme de transfert, un trouble du dialogue car, en principe, c’est toujours l’autre qui diglosse. En effet, l’activité du sujet parlant ne consiste pas simplement à parler: l’écoute, activité signifiante par excellence, en occupe une large part. Dans un dialogue diglossique créole, c’est souvent le français qui parle et la muette qui (partiellement) écoute. En effet, il ne s’agit pas tant de savoir comment les sujets parlent, mais bien de savoir comment ils s’entendent. Dans une situation diglossique, on ne peut jamais vraiment savoir comment on a été entendu.
«Je te parle dans ta langue, et c’est dans mon langage que je te comprends» (Glissant 69)
Une diglossie suppose que l’une des langues soit muette et par conséquent silencieuse. Seule la littérature peut écrire ce silence des langues. Le refoulement diglossique dans lequel la Créolité fonde son espace littéraire répond à la formule «un signifiant, deux langues». C’est peut-être une esthétique voire même une politique, mais c’est avant tout un trouble: c’est le nôtre.
«Les céhêresses(...) pénétraient dans les cases en décalant les portes et envoyaient-monter tables, draps, hardes-cabanes, marmailles, et toutes qualités» (Texaco Chamoiseau).
Le redoublement verbal sans auxiliaire «lever-fâchée» est courant dans la syntaxe du créole (i viré-monté - il remonte).
De même que la langue de Bruand n’était pas celle des communards (lesquels lui jetaient des pierres), la langue de Chamoiseau n’est pas celle du Texaco, actuel quartier de la ville de Fort de France. Il faut être un lecteur assez naïf pour penser que la littérature cherche sa place dans la société alors que c’est précisément dans cette littérature que cette société trouve une image d’elle-même et se situe. (argument défendu notamment par l’écrivain antillais Xavier Orville).
Diglossie lexicale
Créole et français sont des langues parentes, mais cette parenté est presque exclusivement lexicale. Leur phonologie et leur syntaxe les différencient radicalement et ainsi, chacune des langues développe parallèlement une sémiotique autonome. Mais parce qu’il est dépendant lexicalement, le créole n’a pas de sémantique propre. Le lexique est la base sémantique des langues; c’est le lieu à partir duquel se fonde le discours (concept, jugement, raisonnement). A l’échelle du discours, le concept correspond au principe de détachement du sens.
La lexicalité du créole n’est productive que dans ses sémiologies botaniques, ustensilaires et ancillaires, mais elle emprunte toute sa sémantique conceptuelle (vocabulaire des institutions, noms des objets de consommation, informations etc.). En clair, la langue créole est sous assistance lexicale. Elle importe du français son lexique conceptuel et le phonétise.
| 9. | Fok sé fonksyonè-a organizé koyo a-sou an base nasyonal | exemple pris dans le discours syndical |
| Il faut que les fonctionnaires s’organisent sur une base nationaliste |
Dans les langues, le concept porte les univers de discours, lieux du sens, des valeurs de vérité et de la rationalité sémantique. Le reste, c’est-à-dire la grammaire (phonologie, syntaxe) porte les sémiologies, lieux des valeurs signifiantes pures. Le créole possède en propre tous les attributs de la signification, mais il est dépourvu de ceux du sens. La langue créole est sans catégories discursives propres, non pas parce qu’elle en manque, mais parce qu’elle les importe et ne les produit pas.
Ainsi, le créole est privé de conceptualité lexicale. Sa créativité réside essentiellement dans ses tropismes et dans sa grammaire.
Le noeud diglossique créole est donc lexical. Les termes conceptuels du créole sont crées par dérivations paronymiques du lexique français. Cette paronymie maintient, entre les langues, le cordon non-coupé. A ce prix, l’identifiant créole se trouve intégré, mais muet dans le discours de l’autre langue. Ainsi, en créole, la signification est effective, mais le sens est ailleurs.
La Créolité littéraire porte cette lucidité cruelle de faire l’éloge de son propre manque. Elle montre le trait colonialiste inscrit dans la langue elle-même.
Le créole, langue de poétique et de rhétorique orales se trouve exclue du discours littéraire romanesque par sa faible lexicalité conceptuelle. Ainsi le créole possède le modèle du conte et du chant, mais non celui du roman. Le français pour sa part possède celui du roman, assez peu celui du conte, mais fort peu celui du chant (bien que les français s’en contentent).
La vitalité créatrice du créole porte sur sa sémiotique, c’est-à-dire son système signifiant. Mais sa sémantique est contrainte par son manque d’autonomie lexicale. Ce fait de dépendance sémantique barre sa carrière comme langue de pensée.
Le romancier créoliste Raphaël Confiant, dans ce combat entre le pot de terre et le pot de fer, compare la «bicyclette créole» à la «voiture française». Cette comparaison quelque peu «maoïste» est pour le moins douteuse car en Martinique et en Guadeloupe, la bicyclette n’est pas un moyen de transport pour les masses laborieuses, mais un engin de course très perfectionné utilisé pour les loisirs du plus grand nombre, les propriétaires de ces engins possédant généralement aussi une voiture. Néanmoins et plus sérieusement, c’est la Créolité littéraire seule qui crie l’éloge de la langue lexicalement muette, langue privée de roman, de philosophie, de sciences et de presse écrite.
Le cordon lexical francophone n’est pas un trait passager de l’histoire du créole, mais un destin quasi-inhérent dont on sait le détachement présentement impossible. La Créolité fait-elle l’éloge tragique d’une langue assistée à vie? Cette déchirure, cette reconnaissance du manque, cet éloge diglossique, cet éloge de la folie est la topique de son écriture.
Paradoxe de la Créolité
Les écrivains de la Créolité ont dû choisir entre le créole et le roman. Ils ont vécu les limites entre oraliture et littérature. Après avoir écrit abondamment et talentueusement en créole, ils ont, pour l’amour du roman, chuté comme des anges dans la langue de l’autre. Ainsi, paradoxalement, le mouvement de la «Créolité» est né d’un renoncement au créole. Leurs amours contrariées entre la langue et la lettre ont creusé l’espace douloureux d’une diglossie devenue art, car la muette illéttrée (mais non analphabète) à chaque ligne, à chaque mot, refuse de se taire.
La Créolité est un «langage», c’est-à-dire non pas une manière ou un style, mais un sujet vivant dans la commotion des langues. Un «langage» dans cette acception est la trace du frayage du sujet dans les langues dans lesquelles il est représenté
«Il faut frayer à travers la langue vers un langage»(Glissant 81).
Fantasme de la Créolité
Le romancier de la Créolité se considère comme un transfuge qui marronne dans la langue du maître. Cette idée du roman créole écrit en langue maronne relève quelque peu du fantasme car l’autre langue peut-elle être désignée comme la langue de l’autre? Le français aujourd’hui n’est plus la propriété privée des Français, ni l’anglais des Anglais ni l’espagnol des Espagnols ni le portugais des Portugais. Il appartient, dit-on, à quarante sept nations dans le monde. En clair, le français est une langue internationale, une langue du Tout-Monde (Glissant). Elle n’est donc pas la «langue de l’autre», elle est aussi à moi puisqu’elle appartient de droit à tous ceux qui la parlent. Certes, ce français traîne encore la trace de son ancien statut de langue Nord-sud. On remarque par exemple que «francophone» ne se dit que d’un écrivain francophone non-hexagonal. La contradiction qui en découle est élégante: les écrivains français ne sont pas francophones. L’histoire est tenace et ainsi le français, celui de la francophonie, n’est pas encore tout-à-fait décolonisé. Quoi qu’il en soit, français et créole sont mes langues: l’espace de leur commotion est mon langage, c’est-à-dire «moi-représenté».
Le Marqueur de parole
«Petit bonhomme, permets que je t’en baille l’histoire...C’est sans doute ainsi, Oiseau de cham que je commençais à lui raconter l’histoire de notre quartier et de notre conquête de l’En-ville, ...Et si c’est pas comme ça, ça n’a pas d’importance...»
Le roman «Texaco» met en scène un praticien de l’oraliture. Ce «Marqueur de paroles», n’est pas un tabellion qui note ce qui se dit, mais un transfert écrivant ce qui ne peut pas se dire. En clair, ce marqueur est un «marquis», c’est-à-dire un homme aux marches des mondes et des langues, placé par exemple entre «l’enville ‘’lävil’’» du créole et «la ville ‘’lavil’’» du français. Un simple trait de nasalité différencie la sémantique des deux langues: «lavil» (français, aspect affectum) est un lieu, «lävil» (créole, aspect effectum), une conquête, un désir. Dans cette guerre de quartier, métaphore du conflit des langues, le français sort marqué par la trace de la muette. Le «marqueur» trace ainsi dans le signe français, une coupure où s’inscrit la parole de la muette créole. Et cette verve de langue, cette fine alchimie, ce beau travail est son art.
L’Urbaniste Créole et son homologue Egyptien
Le roman «Texaco» raconte l’histoire d’un urbaniste qui vient visiter un de ces quartiers qui poussent comme des mangroves urbaines à la périphérie des villes. Comme pour le marqueur de paroles, l’histoire de cet urbaniste est, elle aussi, celle de la muette qui parle. Le logos de la science urbanistique indique sous forme d’un dilemme que toute construction implique une déconstruction. Pour construire, il faut transiter par un point zéro: il faut raser. «Texaco, delenda est». Le jet bien ajusté d’une pierre reçue en pleine tête va bouleverser cet édifice du savoir. Venant donc raser Texaco et recevant une pierre sur la tête, il tombe les bras en croix, on le croit mort, il se ranime, on le relève et le transporte au «nègre de la Doum», sage du quartier, qui le renvoie à «Marie-Sophie Laborieux» personnage qui dans le texte raconte toute l’histoire.
«De l’urbaniste, la dame fit un poète. Ou plutôt: dans l’urbaniste, elle nomma le poète. A jamais.»
Par ce pointage du «nom», l’urbaniste évitera le point zéro de la table rase, le plan d’un quartier sans habitat ni habitants, en termes clairs et savants, un plan-masse sans sujets parlants. A Texaco, la science urbanistique, à la recherche de son objet, trouve des parlants; autrement dit, elle découvre que l’espace urbain n’est pas un espace sans parole. Le langage de la science est subverti par la reconnaissance du langage tout court. Que dire en effet d’une urbanisation où le facteur langage aurait été oublié un instant: en principe, les humains n’errent pas sans paroles dans les villes. Sur le langage comme sujet urbain, le linguiste F. de Saussure explique:
«Si une rue est démolie puis rebâtie, nous disons que c’est la même rue alors que matériellement, il ne subsiste peut-être rien de l’ancienne. Pourquoi peut-on reconstruire une rue de fond en comble sans qu’elle cesse d’être la même? Parce que l’entité qu’elle constitue n’est pas purement matérielle; elle est fondée sur certaines conditions auxquelles sa matière occasionnelle est étrangère.»
A Texaco, l’urbaniste, en se faisant expliquer la grammaire de la «passe» se fait expliquer la grammaire de la rue. Au Morne Abélard, quartier de Fort de France, l’espace urbain transite par la maison. Dans ce lieu, la rue n’est pas un en-dehors, mais traverse l’habitat. Cette topologie où la circulation transite par le code du langage s’appelle la «passe».
«Loi 35 Tu approches de la passe, cognant ton pied contre la terre en sorte que l’on t’entende venir et que nul ne s’émeuve de te voir déboucher. Et tu cries «la compagnie, bonjour’’ en imprégnant ta voix de l’entrain, du respect, de la gentillesse, de la serviabilité, de la compassion et surtout de l’octave particulière que les personnes discrètes gardent au fond de la gorge. On ne te répondra rien. On attendra de te voir ...»
A Texaco, l’urbanisme reprend son statut de science politique lequel implique de passer par l’écoute de la langue du lieu. En écoutant parler la muette, on apprend à ne pas confondre la «ville» et «l’en-ville». Sur ce sujet, Rabelais écrit:
«Les bâtisseurs de pierres mortes ne sont point escrits en mon livre de vie. Je ne bastis que pierres vives, ce sont hommes.»
Le langage de la science se soumet au préalable du récit épique donné comme fil d’Ariane dans ce labyrinthe de pierres vives. Dans ce long palabre qui donne la grammaire de la passe, la dimension du temps s’ajoute à la tri-dimensionnalité de l’espace urbain. Le quartier devient texte à écouter et à lire.
Les urbanistes des pays du sud retournent inlassablement la question célèbre du maître autrichien Alfred Loos:
«Pourquoi les Papous ont une culture et pourquoi les Allemands n’en n’ont pas ?»
A ce propos, on raconte au Caire une très belle histoire qui illustre cette réflexion. Un urbaniste égyptien, dûment formé dans les grandes universités européennes et américaines se voit confier l’implantation d’une ville en plein désert quelque part entre la ville de Giza au nord et le lac du Fayoum situé à une centaine de kilomètres plus au sud. Dans ce difficile programme dit des «terres nouvelles» dont certains échecs ont été retentissants, l’urbaniste égyptien, comme son homologue créole, est pris dans le dilemme du point zéro: comment construire dans le désert sans le déconstruire, sans partir du principe faux selon lequel le désert est désert. Pour réussir, notre urbaniste inverse la méthode: il prend la pause de l’herméneute et commence par la fin. Il bâtit au milieu du désert un carré de hauts murs richement ornés et y installe un cimetière qu’il nomme «le nouveau cimetière de Giza». Les riches personnes de la ville lointaine ne tardent pas à y faire enterrer leurs morts et attirent autour de cette nécropole du désert une foule d’activités marchandes appuyées sur les hauts murs. Et là, dit-on, se développe progressivement un urbanisme adapté à l’activité agricole nouvellement implantée qui s’étend tout autour. (Cette histoire est exemplaire sinon vraie). Ainsi, si partout la raison est une, partout l’entendement est divers. Comme la mangrove urbaine antillaise, le désert égyptien, c’est aussi «soleil cou coupé».
Eloge de la Créolité «abus de langage et conclusion»
L’Eloge de la Créolité commence par un abus de langage.
«... nous nous proclamons Créoles»
Qu’entend-on par là et jusqu’à quel point cela peut-il se dire? Pour ce qui concerne le sens du mot «créole», il suffit de s’en remettre aux dictionnaires étymologiques, mais pour ce qui concerne les emplois, il nous faudra recourir à une petite analyse synchronique qui nous servira de conclusion.
Synchronie du mot «créole» (sous la forme d’un jeu de langage wittgensteinnien)
La légitimité ou illégitimité de l’emploi du mot «créole» en dehors de la sphère littéraire fait appel à la compétence du sujet parlant. C’est au lecteur de juger de l’acceptabilité des formes présentées. Nonobstant les nuances d’appréciation, on classe les formes en «cas valides, emplois génériques ou spécifiques» ou «cas barrés».
Cas de synonymies:
| 10. | cuisine créole |
| 11. | cuisine antillaise |
| 12. | accent créole |
| 13. | accent antillais |
Cas d’hétéronymies:
| Exemples | Emplois | |
| 14. | meubles créoles
|
meubles coloniaux anciens |
| 15. | meubles antillais |
emploi générique |
| 16. | architecture créole
|
architecture coloniale |
| 17. | architecture antillaise | emploi générique |
| 18. | musique créole
|
musique folklorique |
| 19. | musique antillaise | emploi générique |
| 20. | coutumes créoles
|
coutumes folkloriques |
| 21. | coutumes antillaises | emploi générique |
| 22. | parler créole | cas standard |
| 23. | parler antillais |
cas barré |
| 24. | les parlers
antillais |
variété de parlures |
| 25. | les créoles antillais | variété de langues |
| 26. | créoles de Guyane
|
sujets parlants |
| 27. | créoles de Guyane
|
variété de langues |
| 28. | créoles de Guadeloupe, de Martinique ou d’Haïti | sujets parlants (cas barré) |
| 29. | créoles de Guadeloupe,
de Martinique ou d’Haïti |
variété
de langues |
| 30. | les antillais
de Paris |
emploi standard |
| 31. | les créoles de Paris | cas barré |
La lecture des exemples ci-dessus (dont la liste reste ouverte) montre qu’on ne peut pas se «déclarer créoles» en français sans quelque solécisme. Ceci revient à dire que la Créolité littéraire, créolité vouée au français, peut se crier, mais ne peut pas se dire. Tel est le paradoxe et l’éloge de la muette.
La créolité, ..., a marqué d’un sceau indélébile la langue française. Nous nous sommes approprié cette dernière. Nous avons étendu le sens de certains mots. Nous en avons dévié d’autres. Et métamorphosé beaucoup. Nous l’avons enrichie tant dans son lexique que dans sa syntaxe. Nous l’avons préservée dans moult vocables dont l’usage s’est perdu. Bref, nous l’avons habitée. En nous, elle fut vivante. En elle, nous avons bâti notre langage, ...»
Fort de France 1997
Notes
1Une première
version de ce texte a été publiée in CESURE,
La Commotion des Langues Revue de la Convention Psychanalytique
1996 PARIS
2On dira «forclos», «forclusion»
pour tout objet dont la définition ne peut être que
négative. Toute chaîne signifiante est construite par
des jeux de coupures. Dans le français de la Créolité
littéraire, la langue créole est présente,
mais cachée (inscrite) dans les coupures de la chaîne
français.
Bibliographie
BERNABE J., CHAMOISEAU P., CONFIANT R,. Eloge de la Créolité, Gallimard Paris 1989
CHAMOISEAU P., Texaco, Gallimard NRF 1992
CONFIANT R, Kod Yanm, Editions KDP 1986
GLISSANT E., Intention Poétique, Seuil Paris 1969
GLISSANT E., Discours Antillais, Seuil Paris 1981
PRUDENT L.F.,
Pratiques Langagières Martiniquaises: génèse
et fonctionnement d’un système créole., Thèse
d’Etat Rouen 1993
| |
